Au-delà des évidences : les autres films qui ont fait 2019
Braquons les projecteurs sur des films moins évidents mais tout aussi importants.
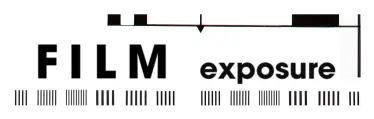 Film Exposure
Film Exposure
Site consacré au cinéma proposant des articles de fond et documentés.
Braquons les projecteurs sur des films moins évidents mais tout aussi importants.
Beaucoup ont considéré l’année 2019 comme un excellent cru cinématographique. Pourtant, c’est souvent les mêmes titres qui reviennent dans les tops individuels et de rédaction. Comme à notre habitude, nous avons décidé de braquer les projecteurs sur des films moins évidents mais tout aussi importants pour l’année écoulée. Une fois n’est pas coutume, nous avons également établi notre top 10 des films de la décennie 2010-2019, à lire ici.
Les choix d’Alex Rallo :
C’est aux temps païens fondamentaux que nous transporte Matteo Rovere avec son péplum intimiste et primal tourné en latin. Péplum, car son cadre historique se prête à la comparaison. Les personnages vivent de rien et ne vivent nulle part. Rome n’existe pas encore, seules quelques cités isolées tentent d’imposer leur non-loi par la force dans la région. Deux frères orphelins, Romulus et Remus, se retrouvent par la volonté des dieux au cœur d’une série d’évènements qui mènera à la création de la civilisation et à la fondation du premier empire européen. Intimiste et primal, car le récit s’intéresse surtout à ce duo fraternel et à sa puissance évocatrice en termes historiques et thématiques. Si l’un incarne la violence brute et l’indifférente nécessaire à l’extirpation de l’homme de la ténébreuse forêt sauvage, l’autre représente les possibilités d’une humanité civilisationnelle guidée par des principes et des lois. Avant tout atmosphérique et mythologique, le film de Rovere explose de temps à autres en fulgurances de brutalité sanglante implacable. Tout est sale, étouffant, opprimant. Et pourtant la lueur d’un futur glorieux imprègne chaque image jouissant d’une photographie luxuriante. D’autres films traitant de la même époque avaient été faits il y a de cela quelques décennies, mais aucun n’atteignait un tel degré d’épure narrative (les dialogues ne se font pas légion) et d’ambition formelle. À la fois proche des personnages et assez ample dans sa mise en scène pour accueillir une richesse textuelle et texturelle renversante, le film s’impose comme le plus injuste oubli de cette année 2019, une thèse païenne et civilisationnelle unique ne cédant jamais aux anachronismes théologiques. La musique n’est pas toujours parfaitement adaptée aux images, mais c’est bien le seul défaut que l’on puisse trouver à cette entreprise hypnotisante.
Vous vous souvenez de Baahubali ? Parfait : l’Inde en remet une couche bien épaisse avec cette fictionnalisation épique de la vie d’un militant nationaliste telegu ayant inspiré ses compatriotes à se révolter contre les colons britanniques au milieu du XIXe siècle. Il faut croire que Tollywood a encore des démons anticoloniaux à exorciser, ce Sye Raa Narasimha Reddy explosant littéralement tous les compteurs du nationalisme disproportionné, à grands coups de scènes d’action invraisemblables et d’exultation d’un sentiment d’appartenance à la terre. Vous trouviez les Indiens grimés en Africains barbares trop hyperboliques ? Attendez de voir ces sales colons d’Anglais maléfiques ici, leur grandiloquence machiavélique n’ayant d’égal que la manière hallucinante avec laquelle ils sont finalement occis. Le réalisateur Surender Reddy parvient ainsi à créer des images étourdissantes et indélébiles, dont l’impressionnante beauté est dépassée sans problème par la portée symbolique. C’est un cinéma de l’exagération, de l’exubérance visuelle et narrative que l’Occident s’interdit désormais d’approcher. L’intrigue lie révolte, trahisons, fidélité maritale et moments de violence stylisée. Rarement l’action à l’indienne aura été aussi dynamique et tendue : en alliant les ralentis depuis longtemps inscrits dans la grammaire nationale à des mouvements secs et rapprochés, Reddy renouvelle la formule de l’épopée indienne en augmentant la solennité narrative d’une approche moderne de la mise en image. Difficile d’imaginer que tout Indien puisse réagir à ce film autrement qu’en éructant « Vive la Mère Patrie ! »
Les choix de Thomas Gerber :
Lise porte un bracelet électronique depuis deux ans. Un soir de fête, alors qu’elle avait 16 ans, elle est restée dormir chez sa meilleure amie. Le lendemain, après que Lise est rentrée chez elle, son amie est trouvée morte, poignardée dans sa chambre. Étant la seule personne à avoir passé la nuit avec la victime, Lise fait office d’unique suspecte et attend son procès, soutenue par ses parents. Inspiré du même scénario qui donna lieu au film argentin Acusada, le second long-métrage de Stéphane Demoustier opte pour une approche beaucoup plus sobre que le film de Gonzalo Tobal. La fille au bracelet n’est pas seulement un excellent film de procès, précis et sec dans ses dialogues comme dans sa mise en scène, il est également un grand film sur une certaine jeunesse. Perçue comme une fille sage par ses parents (le toujours excellent Roschdy Zem et Chiara Mastroianni), Lise se révèle au fil du procès. Stoïque, rationnelle, mutique la plupart du temps et explicite à en être désarmante quand elle prend la parole, la jeune fille expose à la barre sa conception de l’amour et sa consommation de la sexualité. Aucune preuve matérielle ne pouvant être présentée au juge par l’avocate générale (la génialement irritante Anaïs Demoustier), cette dernière transforme le procès pour meurtre en tribunal moral d’une jeunesse débauchée. Le glissement qui s’opère est fascinant, et le pari de l’ambiguïté absolument payant. S’il a charmé la Piazza Grande au dernier Festival du Film de Locarno, La fille au bracelet devrait prochainement faire son effet en salles, la sortie étant prévue pour le 12 février 2020.
Alors que nous les découvrons, Anaïs et Emma ont treize ans. Chacune à sa manière, les deux amies traversent la fin de leur scolarité et vivent leurs années de lycée avant de véritablement entrer dans le monde adulte. En prenant son temps pour capter celui qui passe, Adolescentes nous fait plonger dans le quotidien de ces deux jeunes filles, alternant entre moments clés de l’adolescence et situations en apparences banales.
Cinq ans de tournage, cinq cents heures de rushes, une année de montage : voilà ce qu’il aura fallu à Sébastien Lifshitz pour aboutir à son septième documentaire. Au rythme de vingt-quatre jours par an, il est parvenu à gagner la confiance de deux familles jusqu’à faire oublier sa présence. Des engueulades quotidiennes aux crises amoureuses en passant par les rigolades, le drame familial ou le simple ennui, sa caméra capte autant de moments indispensables pour comprendre cette lente métamorphose de l’âge dit ingrat. Grâce à un sens virtuose du montage et de l’ellipse, le tout prend forme et, à la manière de Boyhood de Richad Linklater, parvient à saisir l’essence même de ces vies qui se font.
Adolescentes, c’est aussi le récit d’une amitié qui dure entre deux jeunes filles que tout semble pourtant opposer. À travers ces deux magnifiques portraits, nous assistons à deux manières totalement différentes d’entrer dans le monde adulte. Avec humour et sensibilité, le film révèle comment Anaïs et Emma se débrouillent pour se construire et comment elles deviennent, peu à peu, actrices de leur propre vie.
Les choix de Jean Gavril Sluka :
Andy (Tye Sheridan), vivant seul dans les années 1950 avec son père (Udo Kier) fait la connaissance de celui qui a lobotomisé sa mère, le Dr. Wallace Fiennes (Jeff Goldblum) qui lui propose de l’accompagner dans une « tournée » visant à faire la promotion de sa pratique à travers plusieurs États américains. Alors qu’il découvre peu à peu le comportement erratique de son mentor, il se rapproche d’une jeune femme, Susan (Hannah Gross), que l’homme qui domine sa vie (Denis Lavant) souhaite faire passer par l’opération pour laquelle Fiennes s’est spécialisé. The Moutain s’inspire librement de la biographie de Walter Jackson Freeman II, un lobotomiste tristement célèbre pour les milliers d’opération qu’il accomplit de manière itinérante, cela même après avoir été déchu de l’ordre médical. Dans un passé dont chaque instant paraît hanté (le film constitue en cela un compagnon de visionnage idéal à The Irishman), Rick Alverson remonte aux racines d’une idéologie américaine matérialiste. De manière passablement retorse, son film part d’un postulat si sinistre qu’il fera au fond difficilement polémique (l’expression du patriarcat, à son faîte, dans l’institution médicale) pour, par une observation épouvantée des dérives que permettent les pseudo-sciences, glisser, un Denis Lavant en état second aidant, vers ce qui apparaît comme la naissance du New Age en Occident. Jeff Goldblum (ici dans son plus beau rôle depuis des décennies) vise juste quand il décrit Alverson comme œuvrant à un cinéma de l’alarmant. Le diptyque que constituait The Comedy (avec Tim Heidecker en nanti pratiquant au détriment des autres une forme d’ironie montrée comme l’expression de son privilège et de la vacuité qui l’accompagne) et Entertainment (avec Neil Hamburger dans son propre registre d’anti-comédie, confronté au vide existentiel) dessinait au présent les contours d’un malaise, non seulement générationnel mais de civilisation : celui du besoin d’être culturellement distrait, anesthésié ; le consentement à, voire le désir de, ne plus être un sujet à part entière. Toujours sur ce thème, profondément politique, il réalise ce portrait historique empreint d’une gravité contre-culturelle (par son rationalisme, aussi), sur des vies dramatiquement rêvées, absentes à elle-même. Sur ce qui advient quand on nie, sur un plan intime, collectif, la vie de l’esprit. (Bande-son de Daniel – Oneothrix Point Never – Lopatin.)
Il est difficile, quand Vincent Maraval dans son propre rôle refuse un script d’Elia Suleiman au motif que ce qu’il raconte en Palestine pourrait se passer n’importe où ailleurs, de ne pas penser au film que nous voyons alors. En trois parties, une à Nazareth, une à Paris (la plus longue), une à New York, le cinéaste palestinien, apatride, se pose à des terrasses de café, des zincs, des tables de restaurants, occupe des chambres d’hôtel – et de là regarde, observe, la marche du monde autour de cette figure lunaire et en retrait. De ces lieux de passage (si on excepte son appartement de Nazareth… quoiqu’il ne paraisse pas pleinement y habiter non plus), ce qu’il donne à voir est non pas ce qui diffère, mais ce qu’il y a en commun, l’homogénéisation du monde par ce qu’on a appelé la globalisation. Parce que pour un réalisateur familier d’une zone de conflit, les grandes villes riches de ce monde ressemblent toutes de plus en plus à son point de départ : les centres-villes faits de touristes, les locaux à cran – et surtout, partout la même flicaille fascistoïde, avec ses véhicules à une roue et ses tenues de chevaliers du Moyen-Âge. Alliant le décalage de Buster Keaton à la décélération de Bresson et Antonioni, Suleiman inscrit sa figure de témoin dans (ou face à) des cadres méticuleusement composés, monte en épingle des motifs de sketchs répétés en boucle qui, en passant outre le réalisme, donnent mieux à voir la réalité à laquelle se confronte ce citoyen du monde. Si « en vrai », on ne croise pas que des clients de Airbnb dans Paris intra-muros et que tout le monde n’a pas un gros calibre vissé à soi dans NYC, l’exagération dit une vérité des lieux. Suleiman s’amuse du reste autant à créer ses propres clichés qu’à en déjouer d’autres (son jeu narquois sur les attendus de la capitale française comme une fashion-week permanente, le chauffeur de taxi new-yorkais qui vit visiblement un grand moment quand son carrosse accueille son premier client palestinien). D’ailleurs, la Palestine dans tout cela ? Plus tant un territoire qu’une idée rencontrée à l’étranger. Une figure angélique poursuivie par des hommes armés, qui leur échappe précisément par ce qu’elle n’est pas de ce monde. Elle le deviendra, affirme un sympathisant à Suleiman mutique… quoique d’après lui, probablement pas de leur vivant.
Les choix de Thibaud Ducret :
Hank et Abby sont ensemble depuis dix ans. Elle rêve de mariage, mais il tarde à faire sa demande. Un matin, fatiguée d’attendre, Abby s’en va sans prévenir, ne laissant à Hank qu’une brève note pour le moins mystérieuse. Effondré, le jeune homme n’est pourtant pas au bout de ses peines : la nuit qui suit le départ de sa compagne, une inquiétante créature tente de pénétrer chez lui. Chaque soir, la bête revient, et Hank entend ses griffes gratter contre sa porte.
Révélés en 2012 par le film d’horreur The Battery, Jeremy Gardner et Christian Stella font partie, avec Justin Benson et Aaron Moorhead (d’ailleurs producteurs de ce nouveau projet), des nouveaux représentants du cinéma de genre indépendant aux États-Unis. Après le survival comique Tex Montana Will Survive!, les deux compères reviennent avec l’étonnant Something Else (récemment rebaptisé After Midnight), sorte de romance mâtinée de fantastique. De fait, le film opère un virage progressif et plutôt réussi dans l’horreur et le genre, mais c’est bien l’histoire d’amour qui dirige avant tout son récit. En parallèle du cauchemar vécu par le héros, abandonné par son âme sœur puis assailli par un monstre métaphorique, l’on suit l’évolution du couple à travers une série de flashbacks, jusqu’à un saisissant plan-séquence dans lequel Hank et Abby font le point sur leur relation.
Si le drame prime, Stella et Gardner (qui tient également le rôle principal) s’autorisent néanmoins de nombreuses touches d’humour, notamment par le biais de l’ami sceptique de Hank qu’incarne leur producteur Justin Benson. À la fois drôle, touchant et effrayant juste ce qu’il faut, After Midnight fut l’une des belles surprises de la Compétition internationale du NIFFF 2019.
Lorsqu’un insaisissable tueur en série s’attaque sans succès au parrain de la pègre locale, policiers et mafieux se résolvent à unir leurs forces pour traquer le dangereux meurtrier. Un pitch relativement classique, pour un film qui, dès son titre, ne prétend pas réinventer la formule, mais promet à tout le moins d’en livrer une exécution sans fioriture qui vise l’efficacité. C’est précisément cette humilité, cette simplicité revendiquée, qui constitue le grand intérêt de The Gangster, the Cop, the Devil.
On pense forcément aux précédentes occurrences du polar sud-coréen que sont Memories of Murder, I Saw the Devil ou The Chaser ; et si le film de Lee Won-tae n’est, à l’évidence, jamais aussi radical que ces prestigieux aînés, c’est sans doute parce qu’il n’entend précisément pas l’être. Privilégiant l’efficience narrative au propos appuyé, The Gangster, the Cop, the Devil évite le discours pataud et moralisateur sur la frontière entre le Bien et le Mal, et parvient malgré tout à traiter ses trois figures principales de façon bien plus maline que le bête manichéisme. Le personnage du flic est ainsi parfaitement ambigu, tandis que celui du gangster force l’empathie, chacun restant pourtant représentatif de son milieu.
Pour son second long-métrage, Lee Won-tae fait déjà montre d’une belle maîtrise technique et livre un polar solide, qui ne se prend jamais trop au sérieux et « se contente » d’enquiller les instants de tension extrême et les scènes d’action percutantes. Passé par les séances de minuit du Festival de Cannes et la sélection New Cinema from Asia du NIFFF 2019, The Gangster, the Cop, the Devil a tapé dans l’œil de Sylvester Stallone, qui souhaiterait en produire un remake américain. Que le projet se concrétise ou non, l’original est à découvrir sans tarder et à savourer sans modération !
Les choix de James Berclaz-Lewis :
Au cœur d’une brume épaisse, une voiture déboule une route sinueuse pour finir avalée par un ravin sans fond. Au volant, une femme : l’épouse de notre protagoniste. Lorsque la rumeur de faits scabreux éclate au sujet de la victime, notre veuf se lance dans une quête imprudente et violente de la vérité, en luttant avec son état émotionnel à l’instabilité croissante. Si le rythme presque léthargique et la palette glaciale d’un certain cinéma scandinave sont bien présents, Hlynur Pálmason en contourne l’indolence habituelle pour laisser la place belle à la colère d’un homme à qui l’on retire abruptement ses repères. Sorte de revenge movie sans coupables, ce film à l’atmosphère délicieusement pesante et portée par une sublime cinématographie qui oscille entre étouffants intérieurs et grands horizons nébuleux. Après le singulier Vinterbrødre, Hlynur Pálmason se profile indéniablement comme un talent à surveiller.
Composé exclusivement d’extraits de livestreams, Present. Perfect. trace des connexions entre des Chinois qui, pour une raison ou une autre, sont caractérisés par leur solitude ou leur marginalité. Le livestream est principalement perçu comme un espace entre commerce et exhibitionnisme, où les « anchors » rivalisent d’indécence pour proposer le spectacle le plus débauché, et par conséquent le plus financièrement juteux. Il n’en est rien ici : une ouvrière papote avec des internautes entre deux coutures dans le bruit incessant d’une usine à plein jus, un artiste de rue sévèrement handicapé cherche le lien social que les hordes de passants qui défilent ne lui offrent pas, un curieux opérateur de karaoké mobile s’adresse à une audience absente, rongé de désespoir et couvert de larmes qui disparaîtront le moment où la prochaine piste s’enclenche. Derrière la terrible banalité de leur contenu, c’est un besoin profondément humain qui transparaît : celui d’être vu, celui d’être entendu. Avec, en filigrane, l’espoir de pouvoir voir et entendre en retour.
Les choix de Sébastien Gerber :
En l’espace de deux films seulement, S. Craig Zahler s’est fait un petit nom dans le cinéma de genre que l’on pourrait qualifié de burné. Il s’était lancé tête baissée dans Bone Tomahawk, un western horrifique particulièrement sanglant où l’on retrouvait Kurt Russell en shérif à la tête d’une escouade confrontée à une bande d’Indiens cannibales. Sans avoir été particulièrement impressionné par ce film qui, selon moi, peinait à trouver son rythme et son style, le nom de Zahler m’était resté en tête. Section 99 (Brawl in Cell Block 99), son film suivant, confirmait que le réalisateur avait eu besoin d’un coup d’essai avant de passer aux choses sérieuses. Avec cette histoire de boxeur qui se retrouvait en prison, dans une formule rappelant la descente aux enfers de Dante sur fond de cinéma grindhouse et bande-son funky, Zahler livrait un film nihiliste d’une violence inouïe, dans lequel il accordait un soin tout particulier à créer des personnages solides et multidimensionnels. Sa carrière parallèle de romancier pouvant être un indicateur de cette écriture précise et détaillée. Le film assoit sa réputation, les critiques sont élogieuses, le suivant sera celui qui le consacrera définitivement comme nouveau patron du néo-noir brutal.
Avec Dragged Across Concrete, Zahler va perpétuer son approche du récit, un mélange de dialogues fleuris, d’ellipses audacieuses et de moments suspendus. Avec plus de 2h30 au compteur, ce dernier film prend son temps. L’histoire, en soit, n’a rien de spectaculaire et s’inscrit dans les grands classiques du genre. Deux flics (Mel Gibson et Vince Vaughn) sur le carreau qui décident de braquer un criminel mystérieux. Deux frères qui vont eux se retrouver à faire les chauffeurs pour le criminel en question. Un braquage brutal, des hommes de main ultra violents et, au final, la confrontation inévitable de tout ce petit monde. L’auteur connaît ses classiques, les codes du genre et va se les approprier pour livrer un « slow burner », un film qui prend son temps pour faire monter la sauce, poser un suspens visqueux avant d’éclater dans ses dernières minutes. En gros, une cocotte minute que l’on aurait oublié sur le feu. Le film brille par cette manière qu’il a de jouer avec l’attente, les ruptures de rythme, les temporalités qui se mêlent et s’entrechoquent et les éclats de violence toujours aussi douloureux qui sacrifient ses personnages sans ciller. Du cinéma qui a ce parfum d’antan, qui pourrait parfois faire penser aux premiers films de Tarantino, avec cette intrigue de romans de gare et sa bande-son funk, mais qui va s’employer à rester plus terre à terre, moins extravagant, talonnant ses personnages jusqu’à leur chute inévitable.
On ne se souviendra pas de The Death of Dick Long comme le meilleur film de 2019. Il y a même fort à parier que le film sombrera dans l’oubli assez rapidement. Ni suffisamment excentrique, hilarant ou à même de provoquer des réactions polarisées, dénué de grande star venue jouer aux tarifs syndicaux (on est pas chez Noah Baumbach), le film de Daniel Scheinert rejoindra, l’on n’en doute pas, la longue liste de ces petits films qui peuplent les festivals et qui s’oublient l’instant d’après. Un triste sort qu’il partagera probablement avec le Dick Long de son titre. Pour les trois du fond qui auraient fait portugrec niveau B1, « Dick », en anglais, est à la fois le diminutif de « Richard », mais aussi un terme familier pour désigner le pénis. Passé la poésie du titre, nous apprenons donc le décès de Dick, que ses abrutis de copains Zeke et Earl ont lâchement abandonné sur le parking de l’hôpital à la suite d’un incident dont nous ne comprendrons la nature que bien plus tard. Avant d’en arriver là, le film va s’employer à suivre Zeke et Earl durant la journée qui suivra le drame et observer minutieusement les répercussions de leur idiotie et du décès d’un homme dans une petite ville d’Alabama où tout le monde se connaît.
S’il fallait comparer The Death of Dick Long à un autre film, le titre qui nous vient immédiatement à l’esprit est Fargo des frères Coen. Chronique de la connerie ordinaire, où la bêtise des uns fait le drame des autres, malaise des secrets de pacotille qui empoisonnent les familles, ces attributs se retrouvent dans le film de Scheinert. Alors certes, n’est pas les Coen qui veut et Scheinert n’a de loin pas l’expérience requise se pour se mesurer à un film comme Fargo. Mais au-delà de cette parenté, The Death of Dick Long fonctionne comme une sorte de prisme du désert émotionnel du campagnard américain. Ces types sans grand avenir, au chômage ou dans des emplois minables, en proie à des problèmes d’addictions, peu éduqués, et qui ne savent plus quoi faire pour affirmer leur virilité et assumer leur identité. La force du film tient dans l’incroyable empathie qu’il déploie pour dépeindre ces types qui peinent à s’émanciper de leur environnement et qui ne semblent pas vouloir quitter leurs rêves d’adolescents, notamment en continuant d’avoir un groupe de neo-metal complètement nul dans le garage de l’un d’entre eux. Le film, souvent drôle et cruel, évite le jeu de la condescendance et s’autorise même une certaine tendresse pour ces deux losers qui auront réussis à tout faire faux jusqu’au bout. Ils sont bêtes à manger du foin, mais l’innocence de leurs aspirations les rend évidemment attachants.
Les choix de Florian Poupelin :
L’animation japonaise nous a, à de multiples reprises, prouvés qu’elle n’avait rien à envier au cinéma dit « live ». Les exemples qui jalonnent ses cent-deux ans d’histoire sont foison et le dernier en date s’intitule Les Enfants de la Mer.
Fable écologique et ode à la diversité de la vie aquatique et de la vie en générale, l’intrigue suit Ruka, une adolescente énergique vivant avec une mère alcoolique, qui ne sait quoi faire de ses vacances d’été. Heureusement, son père travaille à l’aquarium du coin, où elle va rencontrer Umi et Sora, deux enfants élevés dans la mer, qui sentent que quelque chose se trame, quelque chose qui va bientôt appeler toutes les créatures marines du globe à se rassembler au large du Japon.
Réalisé par l’artisan de l’animation Ayumu Watanabe, cette adaptation du manga éponyme de Daisuke Igarashi renverse les codes du film d’exploitation animé et plonge à corps perdu dans une intrigue mystique, avec pour seule frontière celle de l’univers. La réussite du long-métrage tient certes à la qualité technique de sa réalisation et de sa production (sous l’égide du Studio 4°C, à qui l’on doit les classiques Memories, Mind Game et Amer Béton), mais aussi et surtout à sa fidélité à l’œuvre d’origine, autant dans le graphisme que dans le propos qui, l’un comme l’autre, ne se voient à aucun moment lissés. La chronique adolescente, traitée avec justesse, laisse vite place à une intrigue surnaturelle, mystérieuse et fascinante qui se transforme, au cours d’un final métaphysique à couper le souffle, en une sublime métaphore de la complémentarité des espèces (dont l’humain) sur Terre et ailleurs. Le film ne se limite ainsi pas à son aspect écologique, évitant la direction accusatrice qu’il aurait pu prendre, et transcende son propos pour l’amener vers un au-delà universaliste.
Si Watanabe parle volontiers de son amour pour le cinéma de Stanley Kubrick (dont on retrouve ici des échos évidents à 2001: A Space Odyssey) et d’Akira Kurosawa, c’est surtout à Terrence Malick et à son The Tree of Life que l’on pense, notamment dans la manière qu’il a de s’appuyer sur la dimension intime des personnages pour mieux servir une portée bien plus large, plus existentielle. De l’infiniment petit à l’infiniment grand. Et vice versa.
À noter, pour finir, la présence au générique de Joe Hisaishi, que l’on avait plus entendu au cinéma depuis passé cinq ans et qui compose ici un score splendide, à la fois minimaliste et grandiose, à la parfaite hauteur de ce chef-d’œuvre inattendu qu’est Les Enfants de la Mer.
Principalement connu en Europe pour ses deux films primés, Still Life Lion d’Or à Venise en 2006 et A Touch of Sin Prix du Scénario en 2013 à Cannes, Jia Zhang-ke continue son étude de la société chinoise contemporaine avec Les Éternels, sous couvert cette fois-ci d’une histoire de gangsters et d’amour.
Qiao vit à Datong, dans le Nord de la Chine. Elle est danseuse et sort avec Bin, le boss d’une mafia locale. Un soir, la voiture de ce dernier est prise en étau par les membres d’une nouvelle mafia jeune et violente, et Bin se fait tabasser. Qiao s’empare alors d’une arme à feu et sauve la vie de Bin. Elle fera cinq ans de prison pour port d’arme illégal. À sa sortie, elle essaie de retrouver Bin qui durant tout ce temps n’a jamais repris contact avec elle. Elle le retrouvera près du Barrage des Trois-Gorges, où leur réunion sera brève et amère, Bin l’ayant presque oubliée. Qiao n’en restera cependant pas là et fera tout pour retrouver l’amour de Bin.
C’est donc une nouvelle intrigue d’individus pris dans les rouages d’une société que Jia Zhang-ke nous propose ici. Partant comme souvent de sa région natale du Shanxi, il élargit par la suite le scope de son film pour opposer à la campagne en crise économique, l’urbanité effrénée de la province de Hubei où la construction du très polémique Barrage des Trois-Gorges a créé un boom économique sans précédent. À travers cette histoire d’amour, Jia Zhang-ke écrit la chronique d’un pays aux territoires immenses où les classes sociales se perdent entre tradition étouffante et capitalisme appauvrissant. Les deux personnages principaux sont les reflets des effets qu’une telle société peut avoir sur ses membres, sur leurs comportements sociaux, sur leurs choix professionnels, mais aussi émotionnels.
Outre la maîtrise purement cinématographique du film, ce qui le dénote du reste de la filmographie de Jia Zhang-ke est l’inversion des rôles féminin et masculin qu’il explore grâce à son actrice fétiche (et désormais femme) Zhao Tao et à Liao Fan (qu’on a déjà pu voir chez Diao Yi’Nan). D’habitude décrite comme forte, courageuse et endurante, mais néanmoins victime, le rôle de la femme est ici plus actif, plus décisionnaire. C’est elle qui prend le film à bout de bras et le mène là où sa volonté la conduit, à la recherche d’un amour auquel elle croira toujours et malgré tout. De même, celui qui était un gangster fier devient rapidement, et physiquement même, un lâche, un homme détruit, victime donc, totalement écrasé par la société, et qui ne pourra jamais s’en relever.
Finalement, une autre des réussites de ce film, et peut-être la principale, est de synthétiser et de rassembler tous les aspects du cinéma de Jia Zhang-ke. La violence de A Touch of Sin, le réalisme de Still Life, le romantisme de Au-delà des Montagnes et cette chronique, encore et toujours présente, du pays dans lequel il vit et qu’il n’a jamais fuit. L’équilibre qui en ressort est ainsi captivant et bouleversant. Les Éternels est peut-être moins évident que ses prédécesseurs à appréhender, plus subtil, plus fin, mais apparaît, une fois décanté, comme une œuvre somme à la profondeur insoupçonnée.
2 commentaires »